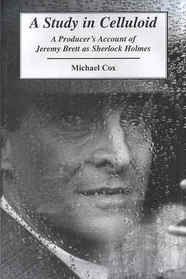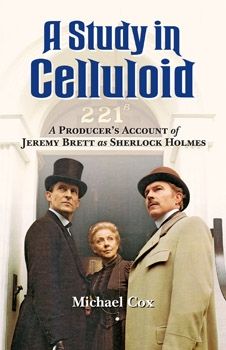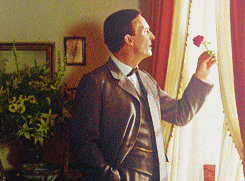
En 1981, nous explique-t-il, les dirigeants des cinq grandes sociétés de télévision indépendantes britanniques peuvent encore montrer ce dont ils ont envie. Et par bonheur, ils ont une exigence culturelle certaine ; leurs sociétés adaptent beaucoup de classiques, ce qui leur apporte un très grand prestige, même si elles produisent aussi des thrillers, des comédies de situation, des feuilletons, qui leur permettent d’engranger des bénéfices et "paient les factures". Sir Denis Forman et David Plowright, donnent donc le feu vert à Michaël Cox.
Cox est un lecteur assidu et passionné de Conan Doyle. On se rend compte, en lisant son ouvrage, qu’il connaît chaque histoire à la ligne près. Le critère qui revient constamment, comme un refrain, lorsqu’il juge une adaptation, c’est la fidélité. Au dénouement de The Naval Treaty, Percy, à qui Holmes a rendu le précieux document, danse de joie ; Cox conclut, avec une satisfaction évidente, que c’est exactement ce que décrit Doyle. Il se réjouit que dans the Speckled Band, rien de l’histoire originale n’ait été changé, alors que d’autres fois, l’adaptation a été plus fidèle à l’esprit qu’à la lettre. De plus Cox est extrêmement attentif aux détails ; c’est un observateur minutieux qui repère le moindre élément discordant, comme les fils électriques modernes près de la cheminée dans The Abbey Grange.
Et il s’appuie sur une équipe animée des mêmes dispositions. A l’aide des 250.000 livres qui lui sont allouées, il entreprend de reconstruire Baker Street à Manchester sur un dépôt ferroviaire désaffecté où est déjà reconstituée Coronation Street. Les designers se plongent dans l’étude du Londres victorien. Cox, son assistant-producteur Stuart Doughty et Nicky Cooney, chargé de recherches, relisent les 60 histoires et relèvent les vêtements et accessoires utilisés par Holmes et Watson, leurs habitudes en matière de nourriture, de boisson, de tabac, leurs caractéristiques physiques, leurs expressions favorites, leurs traits de caractères… L’ensemble de ces précieuses observations est rassemblé dans un guide, The Baker Street File.
Cox recrute un excellent scénariste, John Hawkesworth, qui l’aidera à en choisir d’autres, et apporte naturellement le plus grand soin au choix de l’acteur qui incarnera Holmes. Jeremy Brett lui semble avoir toutes les qualités requises, y compris la formation classique : "For the Hamlet of crime fiction, you need an actor who has played Hamlet". Brett est un partisan aussi passionné de la fidélité canonique que Cox lui-même : il lit, relit, souligne les histoires originales, les compare aux scripts, et réfléchit profondément au personnage qu’il incarne. D’après Dame Jane Conan Doyle, c’est le seul acteur qui l’ait régulièrement consultée pour lui demander son avis sur les adaptations des récits de son père.
Dans The Dancing Men, bien que gaucher, Brett se contraint à écrire de la main droite parce que Holmes est droitier, et s’il se livre à une sorte de ballet sous la fenêtre en cherchant la douille perdue, ce n’est pas par affectation, mais parce qu’il se met dans la peau de Holmes, soucieux de ne déplacer et de n’écraser aucun indice. Les deux champions de la fidélité s’affrontent parfois au nom de la fidélité même. Brett refuse que le "discours de la rose", dans The Naval Treaty, soit supprimé comme l’aurait souhaité Cox, qui y voyait une digression inutile et mal amenée. Brett aurait voulu aussi garder la remarque que fait Holmes, dans le train, au sujet des écoles qui sont selon lui les phares éclairant l’avenir ; mais là, Cox n’a pas cédé, car depuis le wagon à trois côtés tracté sur route que l’équipe avait bricolé, il était impossible de montrer ces édifices.
Comme il n’y a pas d’énigme à résoudre dans The Final Problem, Hawkesworth y développa l’affaire française en se basant sur un fait réel, le vol de la Joconde en 1911. Ainsi, il musclait le récit et justifiait la haine de Moriarty. Brett s’opposa farouchement à cette modification du texte de Doyle, avant de se ranger à l’avis du producteur et du scénariste. Quant à Cox, il désapprouve le saut de joie de Brett à la fin de The Second Stain, ou son geste de poser affectueusement la main sur celle de la maid bouleversée de Silver Blaze, parce que ces manifestations lui paraissent plus brettiennes qu’holmésiennes. Elles se justifient pourtant, du point de vue de Brett, comme moyen de montrer les « fissures dans le marbre » dont semble fait Sherlock Holmes. Heureux temps que celui où deux artistes, également dévoués à Conan Doyle mais obéissant à des logiques différentes, ferraillaient pour la fidélité à l’œuvre originale !
Ce qui fait l’intérêt de cet ouvrage, c’est qu’il est l’œuvre de l’homme qui a lancé la série Sherlock Holmes de Granada et l’a accompagnée jusqu’au Case Book of Sherlock Holmes inclus.
En tant que producteur, il a une vision d’ensemble du travail effectué et des problèmes rencontrés ; son approche est très concrète, et aborde parfois des questions auxquelles le non-initié n’aurait pas même songé.
C’est Michael Cox qui, en 1981, a suggéré à la Granada l’idée d’adapter les histoires de Conan Doyle. Il y avait dix ans qu’on n’avait rien vu de Sherlock Holmes à la télévision. La plupart des histoires étaient tombées dans le domaine public, et n’étaient plus soumises au copyright. Cox voulait produire une série en couleur, de grande qualité, et surtout, fidèle à Conan Doyle.
Ce beau projet, consistant à faire connaître l’œuvre d’un des auteurs de littérature populaire les plus célèbres de Grande-Bretagne au plus large public possible, bénéficiait de toute une série d’atouts majeurs pour réussir, mais il s’est aussi heurté à des difficultés nombreuses, variées et parfois colossales. On pourrait presque sous-titrer l’ouvrage de Michaël Cox : Idéal et Réalité, ou peut-être même Illusions perdues…
Michaël Cox était loin d’être désarmé pour se lancer à la conquête de la parfaite fidélité à Conan Doyle.
Mais il existe un autre obstacle à la réalisation d’une adaptation d’une fidélité parfaite. Et celui-là est considérable ; il a obsédé Cox qui a dû, avec son équipe, faire preuve d’une ingéniosité extraordinaire pour le surmonter, souvent avec succès. Cet obstacle majeur, c’est l’argent, nerf de la guerre, mais aussi de la création cinématographique. C’est pour des raisons d’économie qu’il est bien posé, dès le départ, qu’on tournera le moins possible de scènes d’extérieur et le plus possible de scènes en studio. Les premières sont enregistrées sur film, à raison de 3-4 minutes utilisables par jour, les secondes sur bande magnétique : la qualité est moins bonne, mais on peut obtenir 20 minutes de film par jour, d’où une économie sur la durée de tournage…
Très conscient du rôle de l’argent du fait de ses fonctions, Cox entreprend de vendre la série d’avance aux Américains en échange d’un acompte ; il bénéficiera ainsi d’un supplément de budget de 20%, ce qui représente, explique-t-il, plus de chevaux, de cabs, de figurants…. Mais les dernières histoires de Doyle sont encore protégées par le copyright aux USA, où la loi est différente, d’où un procès et des négociations qui retarderont la sortie de la série jusqu’en 1984. Cox aura son acompte, mais la série n’a jamais pour autant nagé dans une mer de pounds ou de dollars. L’appartement reconstitué de Baker Street n’est pas isolé des bruits extérieurs ; avant chaque séance de tournage, un employé à bicyclette circule en agitant une sonnette pour demander le silence…
A force d’ingéniosité, l’équipe est cependant parvenue à surmonter beaucoup de difficultés. Dans The Norwood Builder, par exemple, Cox sait que l’intervention des pompiers va coûter cher en location de véhicules; mais un de ses assistants trouve un moyen économique de recréer l’animation de la rue : au lieu d’y faire défiler cabs et figurants, on imaginera que s’y déroulent des travaux de réfection de la chaussée, ce qui sera moins coûteux à représenter. Autre astuce dans The Red Headed League : John Hawkes ne dispose que de 50 figurants, mais il les déplace, les fait circuler de manière si ingénieuse qu’on a l’impression d’une foule considérable de « rouquins ».
Malgré l’inventivité de Cox et de son équipe, les problèmes financiers finissent par entraver, dans une certaine mesure, la quête d’une fidélité intégrale. Dans The Crooked Man, les acteurs auraient voulu que les retrouvailles entre Nancy Barclay et Henry Wood aient lieu dans une rue déserte, comme dans la nouvelle, et non au milieu d’une foule de dames de charité et de pauvres venus chercher les vêtements qu’elles leur offrent. Le producteur a calculé à combien reviendrait de faire disparaître les autos, antennes, portes, fenêtres et lampadaires modernes et de tourner une coûteuse scène nocturne, et sa réponse a été un veto formel, en dépit de la colère de David Burke et de Jeremy Brett. Si, au cours du Naval Treaty, le combat entre Holmes et Joseph Harrisson nous est montré sous la forme d’un jeu d’ombres sur le mur, ce n’est pas un choix esthétique : pour ne pas dépasser le temps de tournage qui lui était alloué (time is money), Cox a été obligé de choisir une formule qui lui permette de filmer vite et simplement la scène.
Pour tâcher d’y atteindre, il a fallu affronter de nombreux obstacles, dont certains venaient… de Doyle lui-même. L’écrivain n’était pas toujours cohérent, ni soucieux d’exactitude. Le problème des épouses de Watson (sujet de nombreuses dissertations et controverses dans les Sociétés holmésiennes) est par exemple un véritable casse-tête. Parfois Watson n’est pas marié, parfois il l’est, sans qu’on sache toujours très bien à qui. Cox et son équipe décidèrent donc qu’il resterait célibataire une fois pour toutes. Cette infidélité au canon leur parut nécessaire pour éviter des complications infinies. En outre, les histoires de Conan Doyle paraissent quelquefois inachevées : The Greek Interpreter s’arrête lorsque, Kratidès mort, Latimer et Kemp s’enfuient avec Sofia. Derek Marlowe, le scénariste, a donc dû terminer l’histoire. Dans Shoscombe Old Place, c’est presque le problème inverse, l’énigme étant révélée dès le milieu du récit, que Gary Hopkins a restructuré pour maintenir le suspense. The Musgrave Ritual offre des exemples typiques de remaniements indispensables.
Dans l’original, Watson nous rapporte le récit de Holmes, qui rapporte les paroles de Musgrave, qui lui-même rapporte celles de tiers. Pour supprimer cet écheveau embrouillé de discours rapportés, Jeremy Paul situe l’histoire dans le présent de Holmes et de Watson, ce qui permet de plus de donner à Watson un rôle actif. Doyle avait basé le rituel sur deux arbres, dont l’un est abattu et l’autre a forcément grandi. Jeremy Paul a donc fait de l’arbre un élément décoratif ornant la girouette, ce qui résout le problème. Pour The Priory School, c’est le personnage du Duc de Holdernesse que l’équipe a jugé nécessaire de remanier. Doyle en avait fait un personnage ridicule affublé d’un nez grotesque et d’une barbe rousse flottant jusqu’à la taille, mais aussi un père odieux, coupable de l’enlèvement de son fils. Les scénaristes lui ont attribué de la prestance et une personnalité moins antipathique afin de le rendre plus crédible, plus digne d’intérêt, et de fournir à Holmes un opposant valable. Pour les derniers épisodes, qui mettent en scène les histoires les moins bonnes, les meilleures ayant déjà été utilisées, la fidélité intégrale devient une mission impossible car il faut presque tout reconstruire : l’histoire originale de The Dying Detective ne fournit que le point culminant, où Holmes piège Culverton Smith. Trevor Bowen, le scénariste, doit tout bâtir lui-même à partir de la disparition suspecte du neveu dont Culverton convoite l’héritage.
Même si toutes les histoires étaient parfaitement au point, il subsisterait le problème du passage de la page écrite à l’écran. Pour les deux moyens d’expression, les exigences ne sont pas les mêmes. Comme l’écrit Cox, la grande règle, pour les dramatiques télévisées, c’est "Don’t tell me, show me !". L’action et l’émotion sont indispensables. C’est pourquoi dans The Solitary Cyclist le manège des bicyclettes, raconté par Violet à Holmes au cours du récit de Conan Doyle, est tourné en extérieur et montré aux spectateurs.
Pour ajouter une touche plus dramatique, le cycliste que poursuit Violet disparaît dans le nuage de fumée provoqué par une locomotive (en réalité, il n’y a ni locomotive ni voie ferrée, seulement une machine à fumée et un bruitage). The Copper Beeches est une adaptation très fidèle, mais Paul Annett y a ajouté des éléments de suspense supplémentaires qu’il jugeait nécessaires à l’écran : les plaisanteries énervantes de Rucastle, et l’envol du pigeon effrayé dans la cage d’escalier. Il a renforcé le caractère dramatique du moment culminant de l’histoire : Fowler sauve Alice à l’instant même où Watson et Holmes surviennent, et Rucastle prend Violet pour sa propre fille… Ce type de modification semble inévitable lorsque l’on passe du livre à l’écran, et Cox considère, à juste titre, ne pas avoir démérité pour autant.
Etre économe, c’est nécessaire, mais ce n’est pas toujours facile, ni même possible. Jusqu’en 1987, Granada utilisait des films de 16 mm. Mais ils ne convenaient pas pour le cinéma, et les télévisions américaines se mirent, elles aussi, à exiger que les films soient tournés en 35 mm, ce qui imposait d’utiliser des caméras plus lourdes et plus coûteuses. Granada demanda donc à Michael Fox de réaliser un film de deux heures pour tester ce nouveau matériel, et estimer les frais qu’il entraînerait. Ainsi fut réalisé The Sign of Four avec, ironise le producteur, le matériel qui aurait convenu pour tourner Autant en emporte le vent.
Que l’argent constitue un obstacle parce que sans lui rien n’est possible et qu’on n’en dispose pas en quantité suffisante pour réaliser l’adaptation de ses rêves, c’est une chose. Mais quand l’argent devient le but suprême et la raison d’être d’une entreprise culturelle, c’en est une autre ! En 1989, explique Michael Cox, le gouvernement conservateur, qui voulait une économie de marché totale, entreprit de démanteler le système de diffusion remarquable qui existait jusqu’alors et qui, financé par la publicité, n’était toutefois pas dirigé par elle. Le Broadcasting Act de 1990 a balayé l’ancien système afin d’étendre le secteur privé. Les franchises régionales d’ITV étaient dorénavant vendues aux enchères. Les décisions sur les programmes n’étaient plus prises par ceux qui réalisaient dramatiques ou émissions, mais par les gestionnaires et les comptables. Cox proteste vigoureusement dans son livre contre le règne des hommes d’argent. Selon lui, le rôle de la télévision n’est pas seulement de fournir au public ce qu’il demande à un instant donné et encore moins de suivre tous ses caprices et d’encourager ses extravagances, il est de le former.
Mais, malgré tout ce qu’il a apporté à la compagnie, Cox est licencié par Granada, ainsi que David Plowright. John Hawkesworth ne tardera pas à connaître le même sort… Cox, qui a lancé la série, reviendra diriger The Case-Book of Sherlock Holmes… mais en tant que producteur free-lance. On lui fait payer 1.000 livres par jour pour utiliser le décor de Baker Street, bâti par la série avec ses propres fonds ! The Case-Book n’en est pas moins une réussite, de l’avis même de Dame Jane Conan Doyle. Mais l’optique purement marchande de la nouvelle équipe de Granada va conduire la série dans le fossé. En effet, les responsables de la programmation constatent qu’il existe une forte demande du public pour les films de deux heures. Le taux d’audience étant le seul objectif qui vaille, puisqu’il conditionne les recettes publicitaires, il faut donc faire des films de deux heures, coûte que coûte. C’est parfait pour Inspector Morse, basé sur des romans, mais ça ne l’est pas du tout pour Sherlock Holmes, essentiellement basé sur des nouvelles parfois très courtes. The Hound of Baskervilles n’a pas été un franc succès (impossible de mettre en scène un chien à la hauteur de la description de Doyle avant qu’en 1993 Spielberg ait commencé à composer des images par ordinateur). Peu importe ! C’est ainsi qu’ont été réalisés, en dépit de toutes les raisons de ne pas le faire, The Master Blackmailer, The Last Vampyre et The Eligible Bachelor. Le scénario des deux premiers films a été écrit par le très talentueux Jeremy Paul. The Master Blackmailer est généralement considéré comme une réussite.
Mais dans The Last Vampyre, le malheureux scénariste a dû recourir à toutes les ressources du film d’horreur pour introduire un peu d’action et d’intérêt. Quant à Trevor Bowen, obligé de broder sur la très maigre nouvelle originale The Eligible Bachelor, il en est venu à s’écarter dangereusement du rationalisme holmésien en nous présentant un détective renseigné par ses rêves sur ce qui se passe réellement ailleurs dans le même temps. A l’influence désastreuse de la politique purement comptable de Granada s’est malheureusement ajoutée celle de la dégradation dramatique de l’état de santé de l’acteur principal. Si Brett n’avait pas été aussi désespérément malade, il aurait eu, c’est certain, assez de lucidité et de force pour tenter de s’opposer aux dérives excessives du scénario, du moins en ce qui concernait son propre rôle. De plus, il aurait conservé son extraordinaire énergie, sa magnifique prestance, et sa simple présence aurait suffi à relever l’intérêt du spectacle.
A mon avis, l’entreprise de Cox était véritablement admirable. Elle témoignait d’un respect des œuvres originales, d’un souci de vulgarisation, d’une modestie intellectuelle et de scrupules qu’on aimerait rencontrer plus souvent. Lui et tous ceux qu’il a associés à sa tâche ont fait preuve d’une intelligence, d’une énergie, d’une astuce, d’un courage peu ordinaires et qu’on ne peut qu’applaudir. Tels les Chevaliers de la Table Ronde en quête du Graal, ils ont combattu bien des obstacles et bien des monstres. L’argent n’a pas coulé à flots pour servir leur projet. Ils ont été victimes de l’évolution des temps. Brett a lutté pour jouer de son mieux malgré de terribles maladies avec un courage aussi immense que discret qui force l’estime et la sympathie. Mais l’évolution dramatique de son état de santé a joué sur la série. Et pourtant, avec moins de moyens et de soutiens que d’autres, l’équipe de la série Sherlock Holmes a produit une œuvre qui, même si elle n’est pas parfaite en tous points dans son intégralité me paraît précieuse et même irremplaçable.
J’espère que l’avenir continuera à lui rendre justice comme elle le mérite, en dépit de la versatilité des modes.
Monique CLAISSE
Publié en 1986, l’ouvrage de Michael Cox, "A Study in Celluloïd", est resté épuisé pendant plusieurs années. En 2011, il est réédité par la maison d’édition américaine Gasogene Books. Il retrace l’histoire de la série télévisée, produite entre 1984 et 1994 par la Granada, avec Jeremy Brett dans le rôle de Sherlock Holmes.
Ci-dessous la note de lecture de Monique Claisse.
Toutefois, les problèmes d’argent ont fini par compromettre gravement la série. Il était impossible de filmer Silver Blaze sans montrer à la fin le pur-sang remportant la Wessex Cup, ce qui signifiait la location de nombreux chevaux et l’engagement d’une foule de figurants. Ajoutée aux tournages en extérieur, la Wessex Cup a creusé dans le budget un trou inquiétant, que The Devil Foot a transformé en gouffre. En effet, June Wyndham Davies, alors aux commandes, a décidé de tourner l’intégralité de l’épisode en Cornouailles, ce qui s’est traduit par des frais considérables de transport et de logement. Les épisodes 12 et 13 de la série, prévus après The Bruce Partington Plans, ont sombré dans l’abîme financier ainsi creusé : ils n’ont jamais été réalisés.